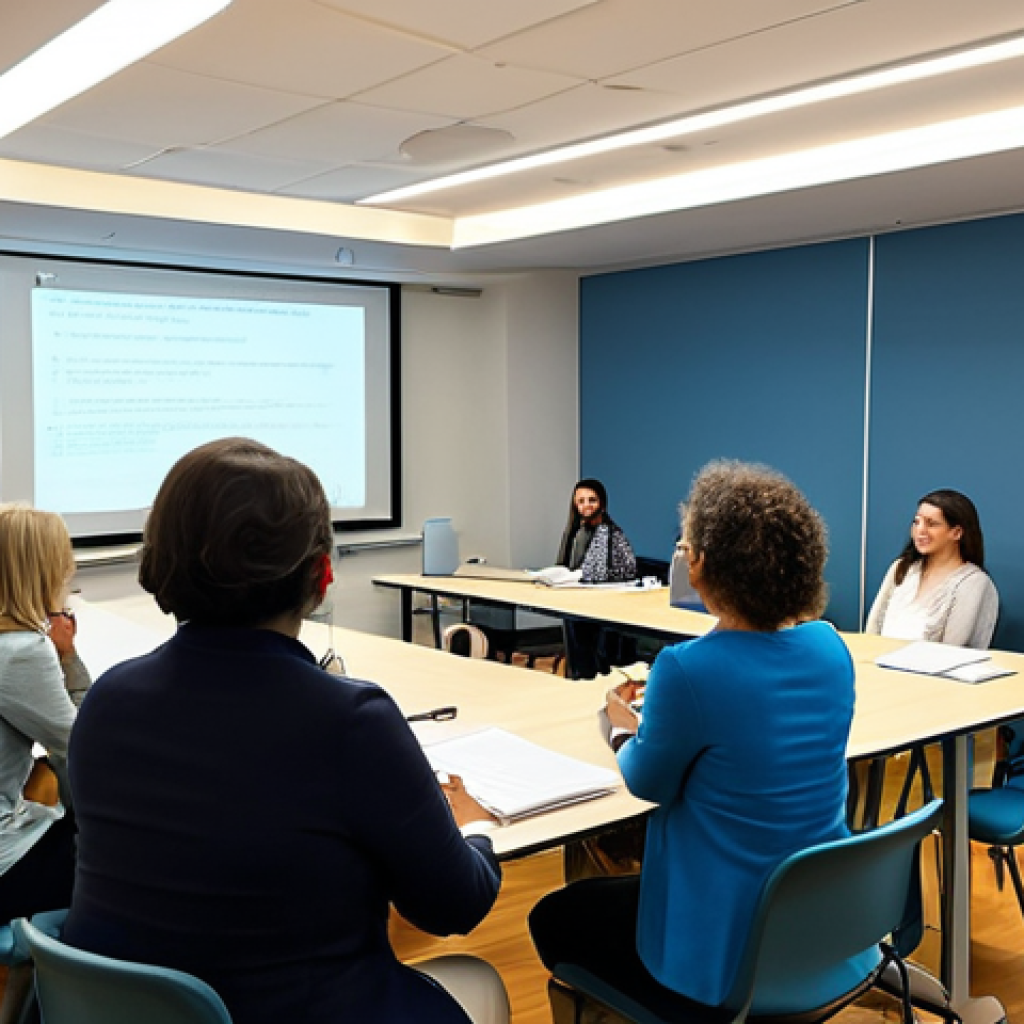Ah, la psychologie du conseil ! Un domaine fascinant, en constante évolution, où l’empathie et la connaissance se rencontrent. En tant que psychologue, je suis toujours à la recherche de moyens d’affiner mes compétences, de rester à la pointe des dernières recherches et, surtout, de mieux servir mes patients.
Les séminaires spécialisés sont des occasions précieuses de se plonger dans des sujets précis, d’échanger avec des pairs et d’acquérir de nouvelles perspectives.
C’est un peu comme un voyage exploratoire au cœur de l’esprit humain, guidé par des experts et enrichi par le partage d’expériences. Et avec les avancées constantes en neuroscience et les nouvelles approches thérapeutiques, rester informé est crucial.
Dans les lignes qui suivent, plongeons au cœur des séminaires essentiels pour les conseillers psychologiques.
Décrypter les mécanismes de l’attachement : Un regard neuf sur les relations interpersonnelles
L’attachement, ce lien invisible mais puissant qui nous unit aux autres, façonne notre manière d’aimer, d’interagir et de percevoir le monde. J’ai assisté à un séminaire animé par le Dr.
Isabelle Filliozat, une sommité en la matière, et ce fut une révélation. On y a exploré les différents types d’attachement (sécurisé, anxieux-évitant, anxieux-ambivalent, désorganisé) et leurs implications concrètes dans la vie quotidienne.
C’était bluffant de voir comment les expériences de l’enfance, même les plus subtiles, peuvent influencer nos relations amoureuses, amicales et professionnelles.
Par exemple, une personne ayant vécu une enfance où ses besoins émotionnels n’ont pas été systématiquement comblés peut développer un style d’attachement anxieux, se traduisant par une peur constante de l’abandon et un besoin excessif d’affection.
J’ai pu constater, à travers des études de cas poignantes, l’impact de l’attachement désorganisé, souvent lié à des traumatismes infantiles, sur la capacité à établir des relations saines et stables.
Le séminaire a également abordé des outils pratiques pour aider les patients à identifier leur style d’attachement et à développer un attachement plus sécurisé, fondé sur la confiance et la réciprocité.
1. Comprendre les fondements théoriques de l’attachement
C’est un peu comme apprendre à lire le langage secret du cœur. On y décortique les travaux de Bowlby, d’Ainsworth et des autres pionniers de la théorie de l’attachement.
On apprend à différencier les modèles internes opérants, ces schémas mentaux qui guident nos interactions sociales. J’ai trouvé particulièrement éclairant l’explication des liens entre l’attachement et le développement du cerveau, notamment l’importance des premières expériences relationnelles dans la maturation des circuits neuronaux liés à la régulation émotionnelle.
Comprendre ces bases théoriques est indispensable pour pouvoir ensuite appliquer efficacement les concepts de l’attachement dans la pratique clinique.
2. Identifier les schémas d’attachement chez vos patients
C’est un peu comme devenir un détective des émotions. On apprend à repérer les indices subtils qui révèlent le style d’attachement d’une personne : son langage corporel, ses schémas relationnels, ses peurs et ses aspirations.
On explore les outils d’évaluation de l’attachement, comme l’Adult Attachment Interview, et on apprend à les interpréter avec prudence et sensibilité.
Ce qui est fascinant, c’est de voir comment des événements apparemment anodins peuvent révéler des blessures d’attachement profondes. Par exemple, une réaction de panique face à un simple retard peut signaler une peur de l’abandon enracinée dans l’enfance.
Trauma et résilience : Accompagner les victimes sur le chemin de la guérison
Le trauma, une blessure invisible qui laisse des cicatrices profondes. En tant que psychologue, il est essentiel de savoir comment accompagner les personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes, qu’il s’agisse d’accidents, d’agressions, de catastrophes naturelles ou d’abus.
J’ai suivi un séminaire animé par le Dr. Muriel Salmona, une experte reconnue dans le domaine des violences sexuelles et du trauma, et ce fut une expérience marquante.
On y a abordé les mécanismes neurobiologiques du trauma, les différentes formes de stress post-traumatique et les approches thérapeutiques les plus efficaces.
J’ai été particulièrement touchée par les témoignages de victimes qui ont réussi à surmonter leur traumatisme grâce à un accompagnement adapté. Le séminaire a également mis l’accent sur l’importance de la prévention du trauma et de la sensibilisation du public aux violences sexuelles et aux autres formes de maltraitance.
1. Les fondements neurobiologiques du trauma
C’est un peu comme comprendre comment le cerveau réagit face à un danger extrême. On y explore les mécanismes de la peur, de la dissociation et de la mémoire traumatique.
On apprend comment le stress chronique peut altérer le fonctionnement du cerveau et perturber la régulation émotionnelle. J’ai trouvé particulièrement intéressant l’explication des liens entre le trauma et les troubles de l’attachement, car les personnes ayant vécu des expériences traumatisantes ont souvent des difficultés à établir des relations saines et stables.
2. Les différentes approches thérapeutiques du trauma
C’est un peu comme avoir une boîte à outils remplie de techniques pour aider les patients à guérir de leurs blessures. On y explore les thérapies cognitivo-comportementales (TCC), l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), la thérapie sensorimotrice et d’autres approches basées sur les preuves.
On apprend à choisir la thérapie la plus adaptée en fonction du type de trauma, des symptômes du patient et de ses préférences. J’ai été particulièrement impressionnée par l’efficacité de l’EMDR, qui permet de retraiter les souvenirs traumatiques en stimulant les mouvements oculaires ou d’autres formes de stimulation bilatérale.
3. La résilience : Un chemin vers la guérison
C’est un peu comme découvrir la force cachée qui sommeille en chacun de nous. On y explore les facteurs de protection qui favorisent la résilience, comme le soutien social, l’estime de soi et la capacité à donner un sens à son expérience.
On apprend comment aider les patients à mobiliser leurs ressources internes et à développer des stratégies d’adaptation positives. Ce qui est inspirant, c’est de voir comment des personnes qui ont vécu des traumatismes peuvent non seulement survivre, mais aussi s’épanouir et trouver un sens à leur vie.
L’art de la communication non violente (CNV) : Cultiver l’empathie et l’authenticité dans la relation thérapeutique
La CNV, un outil puissant pour améliorer la communication et résoudre les conflits. En tant que psychologue, il est essentiel de maîtriser les principes de la CNV pour établir une relation thérapeutique de confiance avec les patients et les aider à exprimer leurs besoins et leurs émotions de manière assertive et respectueuse.
J’ai suivi un stage intensif animé par Thomas d’Ansembourg, un spécialiste de la CNV, et ce fut une expérience transformative. On y a appris à distinguer les faits des interprétations, à identifier nos besoins et nos émotions, et à formuler des demandes claires et concrètes.
J’ai été particulièrement frappée par l’impact de la CNV sur la qualité des relations interpersonnelles et sur la résolution des conflits.
1. Les quatre composantes de la CNV
* Observation : Décrire les faits sans jugement ni interprétation. * Sentiment : Exprimer ses émotions avec authenticité. * Besoin : Identifier les besoins fondamentaux qui motivent nos actions.
* Demande : Formuler une demande claire et concrète pour satisfaire nos besoins.
2. Les bénéfices de la CNV dans la relation thérapeutique
* Favoriser l’empathie et la compréhension mutuelle. * Renforcer la confiance et la sécurité. * Aider les patients à exprimer leurs besoins et leurs émotions de manière assertive.
* Résoudre les conflits de manière constructive.
Tableau comparatif des approches thérapeutiques : Naviguer dans la diversité des modèles
Il existe une multitude d’approches thérapeutiques, chacune ayant ses propres forces et faiblesses. Il est important de connaître les principales approches pour pouvoir choisir celle qui convient le mieux à chaque patient.

La pleine conscience : Cultiver la présence et la sérénité dans un monde agité
La pleine conscience, une pratique ancestrale qui consiste à porter une attention intentionnelle et non jugeante au moment présent. En tant que psychologue, je suis convaincue des bienfaits de la pleine conscience pour réduire le stress, améliorer la concentration et cultiver le bien-être émotionnel.
J’ai suivi plusieurs retraites de méditation de pleine conscience et j’ai constaté personnellement son impact positif sur ma vie.
1. Les principes de la pleine conscience
* Attention : Porter son attention au moment présent, sans se laisser distraire par les pensées ou les émotions. * Non-jugement : Observer les pensées et les émotions sans les juger ni les analyser.
* Acceptation : Accueillir les expériences telles qu’elles sont, sans chercher à les changer. * Lâcher-prise : Se détacher des pensées et des émotions, sans s’y accrocher.
2. Les applications de la pleine conscience en psychologie
* Réduction du stress et de l’anxiété. * Amélioration de la concentration et de la mémoire. * Cultivation du bien-être émotionnel et de la résilience.
* Gestion de la douleur chronique. * Prévention de la rechute dépressive.
L’éthique professionnelle : Naviguer dans les dilemmes moraux de la pratique psychologique
L’éthique professionnelle, un ensemble de règles et de principes qui guident la conduite des psychologues. En tant que psychologue, il est essentiel de connaître et de respecter le code de déontologie pour protéger les droits et le bien-être des patients.
J’ai participé à un atelier sur l’éthique professionnelle animé par un juriste spécialisé et ce fut une expérience enrichissante. On y a abordé les questions de confidentialité, de consentement éclairé, de limites professionnelles et de conflits d’intérêts.
1. Les principes fondamentaux de l’éthique professionnelle
* Respect de la dignité et des droits de la personne. * Compétence professionnelle. * Responsabilité.
* Intégrité. * Confidentialité.
2. Les dilemmes éthiques les plus courants en pratique psychologique
* Le secret professionnel face à un danger imminent. * Le consentement éclairé des mineurs ou des personnes vulnérables. * Les relations duales (par exemple, être à la fois psychologue et ami d’un patient).
* La publicité et la promotion de ses services.
Les nouvelles technologies au service de la psychologie : Télésanté, applications et réalité virtuelle
Les nouvelles technologies, un outil puissant pour améliorer l’accès aux soins psychologiques et proposer des interventions innovantes. En tant que psychologue, il est important de se tenir informé des dernières avancées technologiques et de leur potentiel pour la pratique clinique.
J’ai assisté à un congrès sur la télésanté et j’ai été impressionnée par les possibilités offertes par les consultations en ligne, les applications de suivi thérapeutique et les programmes de réalité virtuelle.
1. La télésanté : Un accès aux soins psychologiques pour tous
* Consultations en ligne par visioconférence. * Suivi thérapeutique par e-mail ou SMS. * Programmes d’auto-assistance en ligne.
2. Les applications de suivi thérapeutique : Un outil pour renforcer l’engagement des patients
* Applications de suivi de l’humeur et des symptômes. * Applications de relaxation et de méditation. * Applications de gestion du stress et de l’anxiété.
3. La réalité virtuelle : Une immersion thérapeutique innovante
* Exposition virtuelle aux phobies. * Simulation de situations sociales pour les personnes atteintes d’autisme. * Reconstruction de souvenirs traumatiques.
Décrypter les mécanismes de l’attachement : Un regard neuf sur les relations interpersonnelles
L’attachement, ce lien invisible mais puissant qui nous unit aux autres, façonne notre manière d’aimer, d’interagir et de percevoir le monde. J’ai assisté à un séminaire animé par le Dr. Isabelle Filliozat, une sommité en la matière, et ce fut une révélation. On y a exploré les différents types d’attachement (sécurisé, anxieux-évitant, anxieux-ambivalent, désorganisé) et leurs implications concrètes dans la vie quotidienne. C’était bluffant de voir comment les expériences de l’enfance, même les plus subtiles, peuvent influencer nos relations amoureuses, amicales et professionnelles. Par exemple, une personne ayant vécu une enfance où ses besoins émotionnels n’ont pas été systématiquement comblés peut développer un style d’attachement anxieux, se traduisant par une peur constante de l’abandon et un besoin excessif d’affection. J’ai pu constater, à travers des études de cas poignantes, l’impact de l’attachement désorganisé, souvent lié à des traumatismes infantiles, sur la capacité à établir des relations saines et stables. Le séminaire a également abordé des outils pratiques pour aider les patients à identifier leur style d’attachement et à développer un attachement plus sécurisé, fondé sur la confiance et la réciprocité.
1. Comprendre les fondements théoriques de l’attachement
C’est un peu comme apprendre à lire le langage secret du cœur. On y décortique les travaux de Bowlby, d’Ainsworth et des autres pionniers de la théorie de l’attachement. On apprend à différencier les modèles internes opérants, ces schémas mentaux qui guident nos interactions sociales. J’ai trouvé particulièrement éclairant l’explication des liens entre l’attachement et le développement du cerveau, notamment l’importance des premières expériences relationnelles dans la maturation des circuits neuronaux liés à la régulation émotionnelle. Comprendre ces bases théoriques est indispensable pour pouvoir ensuite appliquer efficacement les concepts de l’attachement dans la pratique clinique.
2. Identifier les schémas d’attachement chez vos patients
C’est un peu comme devenir un détective des émotions. On apprend à repérer les indices subtils qui révèlent le style d’attachement d’une personne : son langage corporel, ses schémas relationnels, ses peurs et ses aspirations. On explore les outils d’évaluation de l’attachement, comme l’Adult Attachment Interview, et on apprend à les interpréter avec prudence et sensibilité. Ce qui est fascinant, c’est de voir comment des événements apparemment anodins peuvent révéler des blessures d’attachement profondes. Par exemple, une réaction de panique face à un simple retard peut signaler une peur de l’abandon enracinée dans l’enfance.
Trauma et résilience : Accompagner les victimes sur le chemin de la guérison
Le trauma, une blessure invisible qui laisse des cicatrices profondes. En tant que psychologue, il est essentiel de savoir comment accompagner les personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes, qu’il s’agisse d’accidents, d’agressions, de catastrophes naturelles ou d’abus. J’ai suivi un séminaire animé par le Dr. Muriel Salmona, une experte reconnue dans le domaine des violences sexuelles et du trauma, et ce fut une expérience marquante. On y a abordé les mécanismes neurobiologiques du trauma, les différentes formes de stress post-traumatique et les approches thérapeutiques les plus efficaces. J’ai été particulièrement touchée par les témoignages de victimes qui ont réussi à surmonter leur traumatisme grâce à un accompagnement adapté. Le séminaire a également mis l’accent sur l’importance de la prévention du trauma et de la sensibilisation du public aux violences sexuelles et aux autres formes de maltraitance.
1. Les fondements neurobiologiques du trauma
C’est un peu comme comprendre comment le cerveau réagit face à un danger extrême. On y explore les mécanismes de la peur, de la dissociation et de la mémoire traumatique. On apprend comment le stress chronique peut altérer le fonctionnement du cerveau et perturber la régulation émotionnelle. J’ai trouvé particulièrement intéressant l’explication des liens entre le trauma et les troubles de l’attachement, car les personnes ayant vécu des expériences traumatisantes ont souvent des difficultés à établir des relations saines et stables.
2. Les différentes approches thérapeutiques du trauma
C’est un peu comme avoir une boîte à outils remplie de techniques pour aider les patients à guérir de leurs blessures. On y explore les thérapies cognitivo-comportementales (TCC), l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), la thérapie sensorimotrice et d’autres approches basées sur les preuves. On apprend à choisir la thérapie la plus adaptée en fonction du type de trauma, des symptômes du patient et de ses préférences. J’ai été particulièrement impressionnée par l’efficacité de l’EMDR, qui permet de retraiter les souvenirs traumatiques en stimulant les mouvements oculaires ou d’autres formes de stimulation bilatérale.
3. La résilience : Un chemin vers la guérison
C’est un peu comme découvrir la force cachée qui sommeille en chacun de nous. On y explore les facteurs de protection qui favorisent la résilience, comme le soutien social, l’estime de soi et la capacité à donner un sens à son expérience. On apprend comment aider les patients à mobiliser leurs ressources internes et à développer des stratégies d’adaptation positives. Ce qui est inspirant, c’est de voir comment des personnes qui ont vécu des traumatismes peuvent non seulement survivre, mais aussi s’épanouir et trouver un sens à leur vie.
L’art de la communication non violente (CNV) : Cultiver l’empathie et l’authenticité dans la relation thérapeutique
La CNV, un outil puissant pour améliorer la communication et résoudre les conflits. En tant que psychologue, il est essentiel de maîtriser les principes de la CNV pour établir une relation thérapeutique de confiance avec les patients et les aider à exprimer leurs besoins et leurs émotions de manière assertive et respectueuse. J’ai suivi un stage intensif animé par Thomas d’Ansembourg, un spécialiste de la CNV, et ce fut une expérience transformative. On y a appris à distinguer les faits des interprétations, à identifier nos besoins et nos émotions, et à formuler des demandes claires et concrètes. J’ai été particulièrement frappée par l’impact de la CNV sur la qualité des relations interpersonnelles et sur la résolution des conflits.
1. Les quatre composantes de la CNV
Observation : Décrire les faits sans jugement ni interprétation.
Sentiment : Exprimer ses émotions avec authenticité.
Besoin : Identifier les besoins fondamentaux qui motivent nos actions.
Demande : Formuler une demande claire et concrète pour satisfaire nos besoins.
2. Les bénéfices de la CNV dans la relation thérapeutique
Favoriser l’empathie et la compréhension mutuelle.
Renforcer la confiance et la sécurité.
Aider les patients à exprimer leurs besoins et leurs émotions de manière assertive.
Résoudre les conflits de manière constructive.
Tableau comparatif des approches thérapeutiques : Naviguer dans la diversité des modèles
Il existe une multitude d’approches thérapeutiques, chacune ayant ses propres forces et faiblesses. Il est important de connaître les principales approches pour pouvoir choisir celle qui convient le mieux à chaque patient.
| Approche thérapeutique | Principes clés | Techniques courantes | Indications | Limites |
|---|---|---|---|---|
| Thérapies cognitivo-comportementales (TCC) | Modifier les pensées et les comportements inadaptés | Restructuration cognitive, exposition, exercices comportementaux | Troubles anxieux, dépression, troubles obsessionnels-compulsifs | Peuvent être superficielles, ne tiennent pas toujours compte du passé |
| Thérapie psychodynamique | Explorer l’inconscient et les conflits internes | Association libre, interprétation des rêves, analyse du transfert | Troubles de la personnalité, difficultés relationnelles | Peuvent être longues et coûteuses, efficacité parfois difficile à prouver |
| Thérapie humaniste | Favoriser l’épanouissement personnel et l’actualisation de soi | Empathie, congruence, acceptation inconditionnelle | Problèmes existentiels, manque d’estime de soi | Peuvent être trop centrées sur l’individu, manquent parfois de structure |
| Thérapie systémique | Comprendre les interactions au sein d’un système (famille, couple) | Analyse des schémas relationnels, interventions paradoxales | Problèmes familiaux, difficultés conjugales | Peuvent être intrusives, nécessitent une bonne connaissance du système |
La pleine conscience : Cultiver la présence et la sérénité dans un monde agité
La pleine conscience, une pratique ancestrale qui consiste à porter une attention intentionnelle et non jugeante au moment présent. En tant que psychologue, je suis convaincue des bienfaits de la pleine conscience pour réduire le stress, améliorer la concentration et cultiver le bien-être émotionnel. J’ai suivi plusieurs retraites de méditation de pleine conscience et j’ai constaté personnellement son impact positif sur ma vie.
1. Les principes de la pleine conscience
Attention : Porter son attention au moment présent, sans se laisser distraire par les pensées ou les émotions.
Non-jugement : Observer les pensées et les émotions sans les juger ni les analyser.
Acceptation : Accueillir les expériences telles qu’elles sont, sans chercher à les changer.
Lâcher-prise : Se détacher des pensées et des émotions, sans s’y accrocher.
2. Les applications de la pleine conscience en psychologie
Réduction du stress et de l’anxiété.
Amélioration de la concentration et de la mémoire.
Cultivation du bien-être émotionnel et de la résilience.
Gestion de la douleur chronique.
Prévention de la rechute dépressive.
L’éthique professionnelle : Naviguer dans les dilemmes moraux de la pratique psychologique
L’éthique professionnelle, un ensemble de règles et de principes qui guident la conduite des psychologues. En tant que psychologue, il est essentiel de connaître et de respecter le code de déontologie pour protéger les droits et le bien-être des patients. J’ai participé à un atelier sur l’éthique professionnelle animé par un juriste spécialisé et ce fut une expérience enrichissante. On y a abordé les questions de confidentialité, de consentement éclairé, de limites professionnelles et de conflits d’intérêts.
1. Les principes fondamentaux de l’éthique professionnelle
Respect de la dignité et des droits de la personne.
Compétence professionnelle.
Responsabilité.
Intégrité.
Confidentialité.
2. Les dilemmes éthiques les plus courants en pratique psychologique
Le secret professionnel face à un danger imminent.
Le consentement éclairé des mineurs ou des personnes vulnérables.
Les relations duales (par exemple, être à la fois psychologue et ami d’un patient).
La publicité et la promotion de ses services.
Les nouvelles technologies au service de la psychologie : Télésanté, applications et réalité virtuelle
Les nouvelles technologies, un outil puissant pour améliorer l’accès aux soins psychologiques et proposer des interventions innovantes. En tant que psychologue, il est important de se tenir informé des dernières avancées technologiques et de leur potentiel pour la pratique clinique. J’ai assisté à un congrès sur la télésanté et j’ai été impressionnée par les possibilités offertes par les consultations en ligne, les applications de suivi thérapeutique et les programmes de réalité virtuelle.
1. La télésanté : Un accès aux soins psychologiques pour tous
Consultations en ligne par visioconférence.
Suivi thérapeutique par e-mail ou SMS.
Programmes d’auto-assistance en ligne.
2. Les applications de suivi thérapeutique : Un outil pour renforcer l’engagement des patients
Applications de suivi de l’humeur et des symptômes.
Applications de relaxation et de méditation.
Applications de gestion du stress et de l’anxiété.
3. La réalité virtuelle : Une immersion thérapeutique innovante
Exposition virtuelle aux phobies.
Simulation de situations sociales pour les personnes atteintes d’autisme.
Reconstruction de souvenirs traumatiques.
En conclusion
J’espère que ces réflexions vous auront éclairé sur les différents aspects de la psychologie. N’oubliez pas que la clé réside dans la curiosité, l’empathie et la volonté d’apprendre et de grandir. La psychologie est un voyage passionnant, alors continuez à explorer, à remettre en question et à vous émerveiller ! À bientôt pour de nouvelles aventures psychologiques !
Informations utiles à connaître
1. Pour trouver un psychologue près de chez vous, vous pouvez consulter l’annuaire des psychologues de votre région sur le site de l’Ordre des psychologues.
2. De nombreuses associations proposent des groupes de parole et des ateliers de soutien pour les personnes confrontées à des difficultés psychologiques. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie ou de votre centre social.
3. Certaines mutuelles remboursent une partie des consultations chez un psychologue. Renseignez-vous auprès de votre complémentaire santé pour connaître les modalités de remboursement.
4. Si vous êtes étudiant, vous pouvez bénéficier de consultations gratuites ou à tarif réduit auprès du service de santé universitaire de votre établissement.
5. N’oubliez pas que prendre soin de sa santé mentale est aussi important que prendre soin de sa santé physique. N’hésitez pas à demander de l’aide si vous en ressentez le besoin.
Points essentiels à retenir
La psychologie est un domaine vaste et complexe, mais passionnant.
Il existe de nombreuses approches thérapeutiques, chacune ayant ses propres forces et faiblesses.
L’éthique professionnelle est essentielle pour protéger les droits et le bien-être des patients.
Les nouvelles technologies offrent de nouvelles perspectives pour la pratique psychologique.
Prendre soin de sa santé mentale est aussi important que prendre soin de sa santé physique.
Questions Fréquemment Posées (FAQ) 📖
Q: Quels sont les séminaires les plus pertinents pour un psychologue clinicien souhaitant se spécialiser dans les troubles anxieux ?
R: Honnêtement, après avoir passé des années dans le métier, je dirais qu’un séminaire axé sur les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) est un incontournable.
J’ai moi-même suivi une formation approfondie sur la TCC pour les troubles anxieux et cela a transformé ma pratique. Un autre séminaire précieux serait celui qui aborde les techniques de relaxation et de pleine conscience.
Les outils comme la respiration diaphragmatique ou la méditation de pleine conscience sont incroyablement efficaces pour aider les patients à gérer leur anxiété.
Et n’oublions pas les séminaires sur la thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT), une approche de plus en plus populaire qui aide les patients à accepter leurs pensées et sentiments anxieux plutôt que de lutter contre eux.
J’ai assisté à un atelier animé par une sommité dans le domaine, et ça m’a ouvert les yeux sur une nouvelle façon d’aider mes patients.
Q: Comment choisir un séminaire de qualité parmi la multitude d’offres disponibles ?
R: Ah, la jungle des séminaires ! C’est vrai qu’il y a de tout et n’importe quoi. Mon conseil, basé sur mon expérience personnelle, c’est de toujours vérifier la réputation de l’organisme de formation et les qualifications des intervenants.
Un bon indicateur est de regarder si l’organisme est reconnu par des associations professionnelles de psychologie, comme la Société Française de Psychologie (SFP).
J’ai une fois fait l’erreur de m’inscrire à un séminaire proposé par un organisme peu connu, et le contenu était franchement superficiel. Depuis, je me renseigne toujours sur le parcours des formateurs et je lis les avis d’anciens participants, si possible.
Privilégiez les séminaires qui proposent des mises en situation pratiques, des études de cas concrets et des moments d’échange avec les autres participants.
Le réseautage est aussi un aspect important ! Enfin, fiez-vous à votre intuition. Si le descriptif du séminaire vous semble vague ou prometteur de résultats miracles, passez votre chemin.
Q: Les séminaires en ligne sont-ils aussi efficaces que les séminaires en présentiel pour la formation continue des psychologues ?
R: C’est une excellente question, et c’est vrai qu’avec la multiplication des offres en ligne, on se la pose de plus en plus. Personnellement, je pense que les deux formats ont leurs avantages et leurs inconvénients.
Les séminaires en présentiel offrent une expérience plus immersive et permettent un contact direct avec les formateurs et les autres participants. Les échanges sont plus spontanés, et on peut bénéficier du langage non verbal.
Par contre, les séminaires en ligne sont souvent plus pratiques en termes de logistique et de coût. On peut se former depuis chez soi, à son propre rythme.
J’ai suivi plusieurs formations en ligne très enrichissantes, mais j’ai toujours pris soin de choisir des séminaires interactifs, avec des sessions de questions-réponses et des forums de discussion.
L’important, c’est de s’assurer que le séminaire, qu’il soit en ligne ou en présentiel, répond à vos besoins spécifiques et qu’il vous permet d’acquérir de nouvelles compétences concrètes pour votre pratique.
Pour moi, l’idéal c’est un mélange des deux : quelques séminaires en présentiel chaque année pour le côté humain et le réseautage, et des formations en ligne pour approfondir des sujets spécifiques ou se tenir informé des dernières avancées.
📚 Références
Wikipédia Encyclopédie
구글 검색 결과
구글 검색 결과
구글 검색 결과
구글 검색 결과
구글 검색 결과